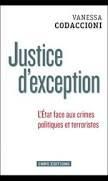Les attentats du 13 novembre avaient durci les dispositifs antiterroristes. Une justice d'exception en passe de devenir la règle ? Au lendemain du drame survenu à Nice, qui a entraîné une nouvelle prolongation de l'état d'urgence, retrouvez notre interview de Vanessa Codaccioni, auteure de “Justice d'exception. L'Etat face aux crimes politiques et terroristes”.
Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences en science politique à l'université de Paris-8, est l'auteur de Justice d'exception. L'Etat face aux crimes politiques et terroristes. Elle revient sur lesattentats du 13 novembre, sur l'histoire et les enjeux de la justice antiterroriste, forme de justice d'exception en ce qu'elle autorise un régime répressif aggravé, différent de celui auquel sont soumis les justiciables « ordinaires ».
Qu'est-ce que les attentats de 2015
ont changé pour la justice antiterroriste ?
Ils l'ont renforcée et confirmé la tendance des gouvernements à radicaliser le dispositif antiterroriste à travers les multiples lois votées par le Parlement. Les événements meurtriers mènent en effet toujours à l'adoption de législations d'exception. Les attentats de janvier ont ainsi conduit à l'adoption de la loi sur le renseignement en juillet 2015, quiétend les pouvoirs des services de renseignement. Ceux du 13 novembre ont abouti à la proclamation de l'état d'urgence — et surtout à la modification de la loi sur l'état d'urgence de 1955. Prévu pour une durée de douze jours, l'état d'urgence a été prolongé pour au moins trois mois et donne un pouvoir accru à la police et à l'administration, en limitant le pouvoir de contrôle de l'autorité judiciaire. Un exemple : le procureur de la République est désormais simplement « informé » en cas de perquisition.
Quelle logique cela révèle-t-il ?
Une stratégie de « neutralisation préventive » : on comprend qu'il vaille mieux empêcher un attentat qu'arrêter ses auteurs une fois qu'ils l'ont commis. Le terrorisme est saisi comme un phénomène global — de l'intention de passer à l'acte à toute forme de soutien, même symbolique. Après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, une centaine de personnes s'étant exprimées sur les réseaux sociaux ont ainsi été inculpées et parfois lourdement condamnées pour «apologie du terrorisme ».
Comment cette action sécuritaire se construit-elle ?
On augmente les pouvoirs des services de renseignement ou policiers, on multiplie les mesures dérogatoires : extension des perquisitions à la fouille des véhicules, surveillance relative aux nouvelles technologies (cyberinfiltration et installation de logiciels espions sur un ordinateur), etc. Les moyens sont ainsi mis sur la surveillance des individus dangereux, sur les enquêtes policières, sur l'instruction des affaires terroristes. Ce qui compte, ce n'est plus ce que j'appelle « la justice jugeante », qui juge et prononce des verdicts, mais la justice policière, qui instruit et enquête. En donnant plus de pouvoir à la police judiciaire, aux agents de renseignement ou aux juges d'instruction antiterroristes, on laisse moins de place à la justice des tribunaux. Voire, on essaie de la contourner pour gagner en rapidité. Avec la loi sur le renseignement de juillet 2015, les dispositifs de surveillance mis en place par les services de renseignement ne sont plus contrôlés par la justice mais autorisés par le Premier ministre.
De quand date la justice antiterroriste ?
C'est le gouvernement Chirac qui, en 1986, a fait voter la première loi antiterrorisme française, après la vague d'attentats qui s'était abattue cette année-là sur la France — revendiquée par le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. Acte de naissance d'une nouvelle forme de justice d'exception, cette loi liste une série de délits « terroristes » et encadre leur répression à travers des mesures policières et judiciaires (garde à vue prolongée, traitement par des juges antiterroristes), et des modalités de jugement spécifiques. Ainsi, depuis 1986, les individus inculpés de crimes en lien avec une entreprise terroriste sont jugés par une cour d'assises spéciale, sans jurés.

La justice d'exception est-elle une tradition française ?
Oui, elle existe au moins depuis la Révolution française, mais on peut la faire remonter plus loin encore avec la justice retenue du roi, c'est-à-dire directement exercée par le monarque ou ses plus proches agents. C'est une justice voulue et contrôlée par l'exécutif pour punir ses ennemis politiques, qui est non seulement attentatoire au principe de la séparation des pouvoirs mais surtout à celui de l'égalité de tous devant la loi. Cette justice politique disparaît en 1981 lorsque la gauche arrive au pouvoir : cette dernière supprime les juridictions d'exception, traite tous les criminels et délinquants comme des « droits communs » et éradique du Code pénal tous les crimes et délits politiques. En 1981, deux évolutions majeures ont donc eu lieu : une dépolitisation de la justice et un traitement indifférencié des justiciables.
Au fil de l'histoire, quels crimes étaient visés par la justice d'exception ?
Les crimes et délits politiques, considérés comme les plus graves : trahison, complot, espionnage, collaboration avec l'ennemi, etc. Au fur et à mesure, la liste a été rallongée. Par exemple, en 1939 et 1940, on a créé les crimes de « participation à une entreprise de démoralisation de l'armée et de la nation » et « d'atteinte à l'intégrité du territoire national » pour pouvoir criminaliser ce que l'on appelait le défaitisme du Parti communiste français. Ces crimes ont été réutilisés ensuite contre les membres du PCF pendant la guerre d'Indochine, puis pendant la guerre d'Algérie. Supprimés par la gauche en 1981, ils ont été remplacés à partir de 1986 par les crimes et les délits dits terroristes. Il en existe deux sortes aujourd'hui : les crimes spécifiquement terroristes, que l'on appelle les « incriminations autonomes » (terrorisme écologique ou financement du terrorisme), et les crimes qui deviennent terroristes parce qu'ils sont « en lien avec une entreprise terroriste » : vol, acte de recel, possession d'armes, homicide, bref des crimes de droit commun mais qui sont« terroristes » car utilisés pour intimider ou terroriser la population.
Pourriez-vous revenir sur ce que fut la Cour de sûreté de l'Etat ?
Cette juridiction d'exception voulue par le général de Gaulle à la fin de la guerre d'Algérie pour réprimer l'OAS a été instaurée par deux lois votées en février 1963 par le Parlement et le Sénat. Ce tribunal spécial, bras judiciaire du chef de l'Etat, possédait toutes les caractéristiques des juridictions d'exception traditionnellement utilisées en France contre des « ennemis intérieurs » : elle jugeait plus sévèrement des crimes ou des délits politiques et autorisait des pratiques policières et pénitentiaires d'exception (garde à vue de quinze jours en cas d'état d'urgence, détention de longue durée, utilisation de « repentis », etc.). Ceux qui comparaissaient devant elle, sur ordre écrit du chef de l'Etat ou du ministre de la Justice, étaient jugés par des magistrats mais aussi des militaires. Créée pour juger l'extrême droite, et malgré les dénonciations de la gauche, elle va aussi, pendant dix-huit ans, juger des espions soviétiques, des collaborateurs ayant fui à la Libération, des militants maoïstes, des indépendantistes corses, bretons ou guadeloupéens. En 1981, le ministre de la Justice, Robert Badinter, demande et obtient sa suppression.
Vous montrez comment la défense de la « communauté nationale » s'est substituée à celle de l'« Etat ».
Avant 1981, toute politique répressive s'appuyait sur la « légitime défense de l'Etat ».Cette conception a été remise en cause par la gauche, qui a fait de l'individu, et non de l'Etat, le centre de ses préoccupations en matière de sécurité. A ce moment-là, le terrorisme mute aussi pour toucher les populations civiles. En 1994, la gauche supprime toute référence à la sûreté de l'Etat dans le Code pénal. Aujourd'hui, on ne réprime plus les atteintes à la chose publique mais aux « intérêts fondamentaux de la nation ». Au-delà des termes juridiques, la façon dont on recourt à l'exception change aussi. La sécurité n'étant plus une « affaire d'Etat » mais un phénomène touchant tous les citoyens, les gouvernants n'utilisent plus les anciennes dispositions comme l'article 16 de la Constitution (qui donne quasiment les pleins pouvoirs au chef de l'Etat), mais privilégient les lois votées par la représentation nationale.

Gauche et droite ont donc eu des traditions très différentes en matière de lutte contre le terrorisme.
Oui, la gauche défendait les principes du droit commun. Il faut relire les déclarations de Robert Badinter dans les années 1980, où il dénonce les « règles exceptionnelles »en matière de justice... La gauche, depuis l'affaire Dreyfus au moins, a toujours défendu les libertés individuelles et craint les erreurs judiciaires, les délits d'opinion ou d'intention, la justice militaire. La droite, en revanche, qui a toujours privilégié la protection des institutions sur les droits individuels, cherche à recourir à des dispositifs spécifiques pour juger les terroristes. La raison d'Etat l'emporte, si l'on peut dire.
Ce clivage semble s'être estompé...
Oui, au moins en ce qui concerne la gauche gouvernementale. Depuis le 11 septembre 2001, les propositions répressives viennent tantôt de la droite ou de la gauche et sont votées. Il y a aujourd'hui un relatif consensus pour durcir l'arsenal antiterroriste et légaliser l'exception, c'est-à-dire inscrire dans le droit des dispositifs qui devraient être limités à une crise, mais qui vont s'institutionnaliser et durer dans le temps. Cela permet au pouvoir politique de rendre inattaquables ces dispositifs et d'en garder le contrôle sans passer par la représentation nationale. Pour les réutiliser par la suite dans un tout autre contexte que celui qui leur a permis d'exister. Le durcissement de la lutte antiterroriste via l'état d'urgence permet ainsi au gouvernement de viser beaucoup plus large : criminalité politique, petite délinquance, militants écologistes, anarchistes, etc. Elle permet un fichage généralisé des individus jugés dangereux.
Si l'exception devient la règle, qu'est-ce que cela implique pour les libertés publiques ?
François Hollande a modifié la loi sur l'état d'urgence. Les termes choisis sont très vagues : on peut dissoudre une organisation si elle trouble « gravement » l'ordre public, assigner quelqu'un à résidence « s'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public ».Cette légalisation de l'exception est inquiétante car on ne sait pas comment elle sera plus tard réutilisée. Et qui sera visé. Il faut cesser cette course en avant et réfléchir à la quinzaine de lois antiterroristes votées depuis 1986. Qu'est-ce qui est utile ou inutile, et dangereux pour les libertés ?

/image%2F1445552%2F20150209%2Fob_1e45f9_logo-communard.jpg)